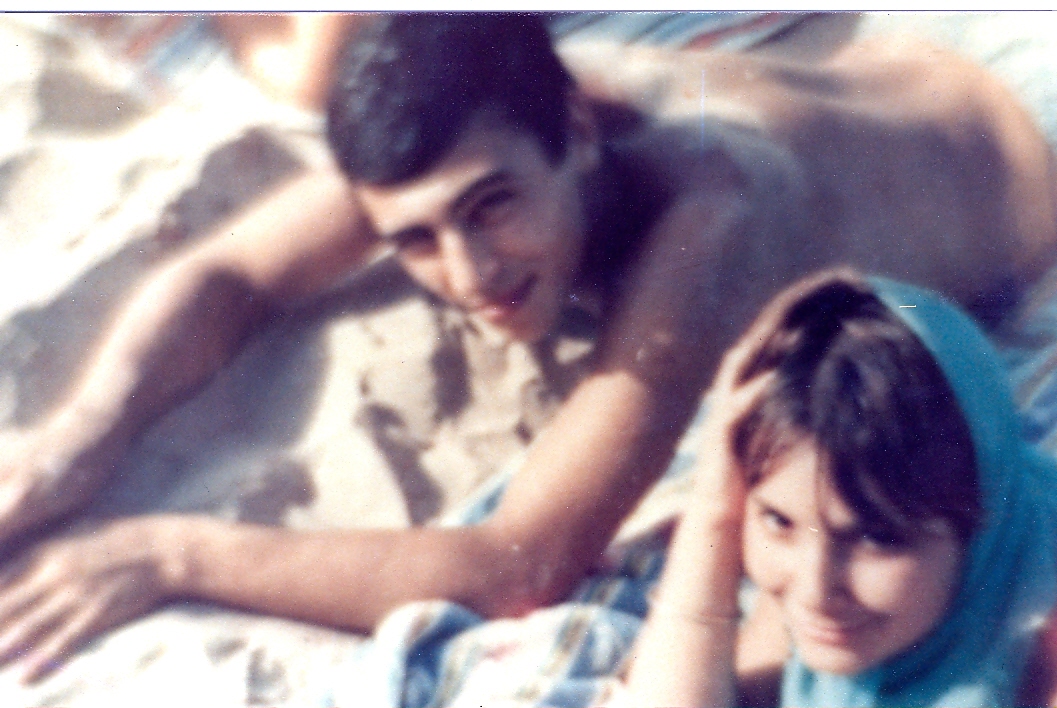1960. D'UN PETIT THÉATRE D'ÉTÉ ET D'UNE CANTATRICE...
- D'UN PETIT THÉATRE D'ÉTÉ ET D'UNE CANTATRICE
HISTOIRE D'UN PETIT THÉATRE D’ÉTÉ
JUILLET-AOUT 1960
QUI NE DURERA QUE LE TEMPS
D'UN FEU DE PAILLE
J'ai vécu cela, le temps d'un feu de paille, une expérience unique de l’été 1960, à Bouisseville, sur la corniche ouest-oranaise, tout près de la résidence secondaire de Christiane Faure– mon inspectrice des Mouvements de Jeunesse et d'Éducation Nationale (MJEP) –, et de sa sœur, Francine Faure, où Albert Camus, décédé en janvier de cette année-là, passait habituellement ses vacances avec leurs jumeaux Catherine et Jean âgés alors de 13 ans.
********************************************
Pour le programme de ce Petit Théâtre d’été, que Christiane Faure avait créé pour meubler son séjour à la plage et ne pas rester inactive alors qu'elle et sa sœur étaient encore sous le coup de l'accident brutal qui avait emporté l'homme de la famille, c'est à Henri et Yvette Cordreaux, animateurs de théâtre très prisés dans tout le Maghreb qui résidaient à Alger, qu'elle avait fait appel. Et les Cordreaux lui avaient proposé de reprendre en appoint d'un spectacle classique qu'ils avaient montés à partir de l'œuvre de François Rabelais et joués un peu partout en Algérie, une pièce de théâtre mise en scène par un de leurs élèves surdoué, Abderrahmane Kaki – celui qui fondera deux ans plus tard le Théâtre National Algérien –, d'un auteur contemporain : La cantatrice chauve d’Eugène Ionesco.
L’enjambement était époustouflant : rabelaisien et gargantuesque !... Susceptible de faire un pied de nez et de narguer le public bourgeois de cette petite station balnéaire, où la famille d’Yves Saint-Laurent passait ses étés.
Mais, sur le moment, je n’en mesurerais pas l’ampleur, puisque je n’avais, pour références en théâtre, à part les trois pièces que nous avions montées dans le cadre de l'AEAJ (Association pour l'Éducation Artistique de la Jeunesse) et du Festival de Théâtre de Mers-el-Kébir, sous l'oeil vigilant de Christiane Faure puisque c'était elle qui les avait fondés : On ne badine pas avec l'amour d'Alfred de Musset, La dévotion à la croix de Pedro Calderon de la Barca, adapté par Camus, et L'espagnol courageux de Miguel de Cervantes adapté par Emmanuel Roblès, que les pièces de théâtre que j’avais aimé lire : les classiques bien sûr et les romantiques surtout, celles de Victor Hugo, Alfred de Vigny, Heinrich von Kleist, Frederick von Schiller… mais plus passionnément celles de Tchekhov, Claudel, Péguy, Shakespeare… et, aussi, puisque j'étais un hispanisant, toutes celles écrites par les dramaturges du Siècle d’or espagnol : Lope de Vega, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcon, Pedro Calderon de la Barca…
Sans jamais cependant avoir entendu parler, puisque je vivais loin de Paris, alors qu'il avait commencé à se faire connaître 10 ans auparavant, d’Eugène Ionesco et d'aucune autre pièce de son répertoire.
Mon étonnement et ma surprise furent d’autant plus forts, dès avoir entendu les premières répliques de cette Cantatrice chauve, qu’il me fut facile de penser aussitôt, en gloussant de joie, qu’on ne pouvait pas avoir mieux choisi comme spectacle pour agacer, secouer, désarçonner et ébranler les fausses certitudes et les assurances qui, dans cette époque d'instabilités politiques émaillée d'attentats sanglants, confortaient illusoirement le bourgeoisisme de repli, pantouflard et renfrogné, des Oranais privilégiés qui voulaient encore, alors que leur cause était déjà perdue, se persuader que l'Algérie resterait française...
Bouisseville, petite station agréable mais assez banale architecturalement, restait néanmoins, parce qu'elle était facilement accessible et très proche d'Oran, très fréquentée toute l'année et très vivement animée dès les premiers beaux-jours. Avec cet été-là, qui était le premier sans Camus à Bouisseville, une recrudescence de population drainée sur la côte par la promesse de bains rafraichissants et de farniente au soleil pour échapper, par manque d'espérances, au mal de vivre, à la hantise d'être chassé de chez soi ou de perdre la vie... Craintes obsessionnelles que tous les habitants éprouvaient mais qui compromettaient surtout les aises de ceux qui étaient bien installés et qui, selon l'expression courante ,« avaient les moyens ».
Je dis cela en me mettant dans le lot car la plupart d'entre nous étions persuadés, sans vouloir prendre conscience des faits historiques dans lesquels, par la force des choses, nous étions impliqués, de leurs réalités et de leurs cruautés meurtrières, en estimant que la France sortirait triomphante de ce que nous nous entêtions à appeler l’insurrection algérienne puisque nous nous étions persuadés qu'elle n'était qu'une simple éruption de mécontentement qui trouverait son apaisement bientôt, après des négociations et l'octroi, à tous les citoyens vivants sur le territoire algérien, de leurs pleins droits civiques.
Moi qui étais revenu blessé dans l’âme des trois années passées dans l’armée, de 1954 à 1957, et qui avais pu déplorer à mon retour, l’inconscience dont mes amis de l’AEAJ, plus jeunes que moi et qui n'avaient pas rempli leurs fonctions militaires, faisaient preuve – sans doute pour donner le change et croire qu'ils étaient à l'abri et ne seraient pas affectés par les événements –, prenais conscience soudain, dans la confrontation avec cette pièce de théâtre qui s'opposait catégoriquement à l'ambiance et au climat du temps, parce qu'elle était incongrue, complètement déconnectée de nos préoccupations lancinantes et de nos angoisses obsédées, de la force corrosive, déstabilisante, inquiétante que pouvait susciter une forme singulière d'écriture basée sur une certaine qualité particulière d'humour : celui, transgressif, exceptionnel et indéfinissable d’Eugène Ionesco.
Et j’imaginais, par avance, avec un certain méchant plaisir, en me frottant les mains même, le coup de fouet salutaire que cet humour-là, véhiculé par des personnages désopilants, allait pouvoir administrer à tous les spectateurs de ce Petit Théâtre d’été, en sachant bien qu'ils étaient pour la plupart d'entre eux des vacanciers riches, gâtés, bronzés et soigneusement “emparurés”, mangeant plus qu’à leur faim, veillant scrupuleusement à leur petit confort et s'en flattant… mais qui se bandaient les yeux pour ne pas voir ce qui se préparait et se persuader qu'ils étaient innocents de ce qui arrivait … Grossissait... En s'aggravant... En empirant... Jusqu'à n'être plus maintenant qu'à proximité... Où qu'on aille... Une immense charge explosive... Là... Tout près... Sous nos pieds... Qui enflait de jour en jour, et ne tarderait pas devenir fournaise “enflambant” la ville entière…
Mais la question plus intéressante que je me posai alors, puisque j'en étais encore, et pour toujours, aux préoccupations que décrit, dans La Mouette, Anton Tchekhov, celles d'une « bourgeoisie qui ne se préoccupe principalement que de carrière ou d’histoire d’amour et de bien-être » en se détournant, par peur d'en prendre conscience et par lâcheté, de la crise politique et sociale qui mine leur devenir, se résumait à une seule phrase prononcée par Tchekhov lui-même, en la prêtant à son protagoniste Konstantin Gavrilovitch Treplev, qui, pareille à une formule magique, résonnait comme un espoir d'aboutissement en une vie radieuse, éternellement meilleure : « Trouver des formes nouvelles pour exprimer des idées nouvelles ! »
« Le talent, c'est la hardiesse, l'esprit libre, les idées larges ! » disait encore Anton Tchekhov tandis que je me perdais en conjonctures, réfléchissant après coup sur l'ébranlement d'esprit que m'avait procuré cette cantatrice – qui devait certainement souffrir du tort, selon ce que nous nous disions en ricanant lorsque nous parlions de malheur, d'avoir un peigne mais pas de cheveux –, en me demandant dans une totale perplexité : D’où pouvait venir cet humour-là ?... De quelles conjonctures et coïncidences était-il né ?... En quels lieux, Eugène Ionesco, était-il allé le chercher ?... A quelles sources l'avait-il puisé ?...
Des questions qui tombaient sous le sens et que j'oserais lui poser, de vive voix, lorsque je prendrai la hardiesse, quatre ans après, en 1964, de frapper à sa porte pour le rencontrer... En bénéficiant tout de même d'une introduction et pas des moindres puisque c'était celle de la directrice du Théâtre de Poche, André Delmas, et parce que je faisais partie d'un groupe que nous avions formés autour d'Arlette Bonard et de Monique Hermant, (notre professeur d'improvisations à l'École d'art dramatique du TNP), et que nous disposions dans l'arrière de ce petit théâtre qui était un ancien café, d'une salle de répétition et que nous présentions chaque soir, en début de soirée, sur la petite scène, dans la salle d'une trentaine de places à peine, des lectures spectacles et des poétiques... Et parce qu'Eugène Ionesco habitait aussi, tout près de ce petit théâtre sur le même Boulevard, celui du Montparnasse, au quatrième étage du 96, non loin des grandes brasseries célèbres de la coupole et du Dôme où se pressaient tous les artistes du monde qui séjournaient à Paris.
Notre première rencontre fut cependant plutôt froide. Eugène Ionesco et Rodica, son épouse, mine de rien, tournaient autour de moi comme s'ils me reniflaient pour savoir si je n'étais pas porteur de vermine et de pestilence... Et ce, même après... lorsque embarrassé et transi... Je leurs eus dit que je ne venais que... Pour demander... S'il était possible.... parce que je me préoccupais de Théâtre pour jeune public... Qu'il soit revigoré et régénéré...
A les voir me regarder comme si je tombais du ciel, lui avec ses gros et grands yeux inquisiteurs et elle avec malice et ironie, sans me prendre réellement très au sérieux, j'avais de quoi augurer que j'étais venu pour rien et que ma démarche resterait lettre morte.
Pourtant et fort heureusement, Eugène Ionesco étant un homme d'esprit et un finaud, sincère, franc et honnête, dont tout le comportement, à mille lieues de l'affectation et du porter beau et faux pour paraître, reflétait ce que Sartre appelait l'authenticité de l'être, je gardais un espoir... J'avais eu l'intuition dans la manière souriante dont il avait fini par me regarder qu'il ne pouvait pas être insensible à mes doléances et qu'il avait très bien perçu à travers ma spontanéité naïve et directe, ma sincérité et le bien fondé de ma demande...
Mais sans être assuré cependant, que Rodica, son épouse était du même avis car, fine mouche de même espèce que son bonhomme, elle avait choisi plutôt, en tant qu'inspiratrice de l' homme de plume soutien de la maison qu'il était, alors qu'elle était aussi lettrée que lui, de faire celle qui n'avait pas droit à avoir des avis en matière de théâtre car son rôle se limitait à veiller au grain, à la cuisine, au repassage et à l'entretien du logie.. Tournant autour de nous, « pas folle la guêpe ! », elle affectait, en bonne hôtesse d'accueil, de jouer les maîtresses de maison parfaites, en me proposant de prendre place dans le canapé, ses bons soins et en finissant par nous offrir aimablement des rafraichissements...
Facile cependant pour moi de comprendre, qu'elle n'entendait rien perdre de ce que son mari et moi allions nous dire mais qu'elle feignait, pour mieux connaître le but de ma visite et me percer à jour, de faire semblant de ne pas y prêter attention : « Un p’tit whisky pour vous monsieur Vidal, n'est-ce-pas ? … Mais pas pour toi, Eugène, hein, tu le sais bien !... C’est le docteur qui l’a dit !... Un campari seulement !… C’est pour ta santé !... »
Et puis, heureux coup du sort, comme si le ciel s'entrouvrait, tout changea en un clin d'oeil et du tout au tout lorsque je me mis à raconter, pour rompre la glace et entrer dans le vif du sujet, comment mon fils riait aux éclats lors de la répétition, à Bouisseville, de La cantatrice chauve, dans le cadre de ce Petit Théâtre d'été…
Eugène Ionesco était soudain très ému, presque aux larmes de reconnaissance, tandis que Rodica, fière et altière, agitait sa tête d'acquiescement pour exprimer qu'elle s'en était toujours douté, qu'elle savait, qu'elle avait toujours pensé que cette pièce était géniale, tonique et bienfaisante pour tout le monde et même pour les enfants !...
Mes explications étaient circonstanciées. Il m’était facile, puisque j'en gardais un souvenir inoubliable, de leur reparler de ce moment de bonheur à jamais perdu et de leur reraconter comment et pourquoi, au cours de cette répétition, en fonction des réactions de mon fils, l’idée saugrenue, folle, presqu'incompréhensible, m'était venue de me promettre à moi-même que je devrais, dès que je le pourrais, rechercher l'auteur de cette cantatrice improbable, afin de lui demander de m’aider, en participant et collaborant, à changer par plus de désinvolture, moins de sérieux et de bonnes intentions, selon une tournure plus dégagée et moins chargée de commisération, la teneur des pièces de théâtre que l'on offrait aux enfants.
Et mes questions à Eugène Ionesco fusaient, portant plus particulièrement sur la raison qui l'avait incité à adopter pour ses pièces ce parti-pris d'humour-là, et cette qualité spécifique d'humour cinglant, tandis que sous l'assaut de mon empressement, il faisait semblant, en levant ses mains au-dessus de sa tête pour se protéger, d’être assailli et menacé d’ensevelissement...
En somme, enivré par avance du plaisir de l’entendre de sa bouche, je bouillais d’impatience de comprendre pourquoi son théâtre était ce qu’il était... Et, ne doutant de rien, bercé par l’utopie, ne me rendant absolument pas compte de la situation dans laquelle je le mettais, ni de l’importance de ma demande, je n’imaginais rien de moins qu’il saurait magiquement, en trois coups de cuiller à pot, m’expliquer qui il était ?... En qui et en quoi il croyait ?... A quelles sources il avait bu ?...
Merveille des merveilles, Eugène Ionesco se prêta à mon jeu. Ma naïveté jouait en ma faveur. Sans enflure ni véritable théorisation, ses phrases étaient simplement dites, lapidairement, avec une évidence confondante, empreintes de bonhommie... Rassurantes et apaisantes... Me donnant même l’impression que je ne lui paraissais pas trop stupide, que nous avions sympathisé et que nous pouvions avoir, en partage, une communauté d'engagements humanistes et les mêmes curiosités avides pour cet univers d’expression et d’échange qu’était le théâtre.
En peu de mots, rapidement dit, comme s’il feuilletait sans s’appesantir des pages de sa jeunesse, Eugène Ionesco me permit de comprendre qu’il écrivait sans machiavélisme mais à partir du ressentiment qu’il avait éprouvé, en Roumanie, contre la versatilité et la lâcheté de son père… Celui qui avait été pronazis en 1938, et solidaire, en 1941, de la Wehrmacht, des Hongrois et des Italiens fascistes, ennemis alors de l’Armée rouge… Puis, du même père, qui avait résolument et radicalement tourné casaque et changé de bord, pour collaborer pleinement, de gaieté de cœur, avec les communistes, en 1944, lorsque les troupes de l’URSS avaient envahi les pays de l’Est européen pour s'implanter en Roumanie…
La mère d’Eugène Ionesco était française mais il n’en parlait pas. Lisant intuitivement dans ces pages de sa vie qu’il me passait sous le nez, je cherchais encore vainement des réponses qui m’expliqueraient les raisons de son humour. Je crus alors pouvoir penser, par analogie avec la révolte que j’avais éprouvée autrefois contre mon père mais pour d’autres raisons, qu’il avait puisé les racines de son humour dans une rébellion contre la langue roumaine de son père. Langue latine comme la nôtre !... Ce qui lui permettait, implicitement, de se servir et d’appliquer au français, par travestissement et sublimation, ce qu’en fait il détestait dans les poncifs de sa langue paternelle ! …
Ce n’étaient qu’hypothèses !
Des déductions qui s’étaient imposées à moi tandis qu’Eugène Ionesco me parlait... puis qui s’étaient confirmées par la suite, à la réflexion, tandis que je m’efforçais de retrouver des raisons précises qui expliqueraient la qualité singulière de son théâtre.
En fait, cette question de “formes nouvelles suscitant des idées nouvelles” que j’avais puisée dans La Mouette de Tchekhov, me revenait souvent en tête alors que je n’avais pourtant pas envie d’écrire moi-même, ni de la mettre en application d’une façon ou d’une autre... Il s’agissait pour moi simplement de comprendre !... Mais sans objectif précis… Sinon celui de la connaissance et du savoir !...
Réflexions et déductions qui débouchaient toujours, en cul-de-sac, en me ramenant à ce que j’avais autrefois déduit des choix de rôles sulfureux qu’on attribuait à Gérard Philipe et qu’il ne reniait pas puisqu’il choisissait de s’y investir : Caligula notamment !... A peu de différences près, mais plus surement encore, les raisons qui avaient incité Gérard Philippe à se révolter contre les idées politiques fascistes de son propre père me semblaient lumineusement manifestes pour expliquer ce qu’il avait voulu devenir pour ne pas ressembler à son géniteur... La différenciation était impérative et obligatoire : Il ne se différencierait qu'en s’opposant pour se construire, selon ses codes et ses valeurs... Ces raisons haïes avaient été la forge, le creuset et la source où, dès l’enfance, il avait puisé pour devenir, l’homme de cœur, le syndicaliste et l’artiste qu’il était devenu...
« Vous savez, me dira Eugène Ionesco, après que j’eus dégusté mon whisky et qu'il eut, lui, en faisant la grimace, avalé son campari… Les raisons sont multiples et les recettes pas toujours explicables… Pour généraliser et ne parler que des plus évidentes je dirais facilement que mes raisons s’inventent d’elles-mêmes, systématiquement, contre tous les conformismes… Quels qu’ils soient… J’ai l’impression d’être à la chasse et de lever des lièvres chaque fois que l’un d’entre eux se présente… La raison raisonnante nous en sert bien quelques dizaines par semaine… Tenez, par exemple et en particulier… Ce théâtre politique de Sartre et de Camus, qui a pourtant pignon sur rue depuis la fin de la guerre à Paris !... Il parait moderne et contemporain alors qu‘il est encore et surtout bourgeois – genre de reproches qui étaient analogues à ceux que fera Simone de Beauvoir, à plusieurs reprises, à Jean-Paul Sartre –, engoncé et figé, structurellement, autant dans la forme que dans les idées… Déjà daté ! ... Je ne l’ai probablement perçu, moi qui ne voulais pas l’imiter et qui ne voulais rien lui devoir, que parce que je ne voulais pas être statufié... Car être statufié me paraissait alors, et me parait encore, comme le pire des conformismes !...»
Eugène Ionesco me dira immédiatement après qu’il n’avait pas donné son autorisation à Abderrahmane Kaki par hasard… Puis revenant sur ce théâtre contre lequel il s’était insurgé, il insista pour me dire qu’il le connaissait bien, qu’il en avait été nourri, mais qu’en choisissant d’en faire son champ d’action et son créneau, il n’avait pas pu s’empêcher de s’en écarter pour ne pas avoir l’impression d’être un copieur, un arrangeur-manipulateur, un faiseur de vieilles soupes... « Et même encore mieux, me dit-il en souriant et en ressortant de son chapeau cette idée de lièvre qu’il trouvait à tous les carrefours de sa vie, j’en ai fait mon terrain de chasse, prêt à tirer sur tout ce qui ressemblait à des idées reçues !... »
En souriant mais en revendiquant son statut de chasseur, donc armé, l’humour étant son arme, Ionesco avouait ainsi qu’il avait pris pour cible, et pour contre-exemple, ce genre de théâtre dont Sartre, Beauvoir et Camus, étaient pour les intellectuels de notre pays, en opposition au théâtre de boulevard, les représentants les plus prisés de cette période d’après-guerre.
Dans ce champ des arts et lettres, c’est probablement pour faire comme Sartre, Beauvoir et Camus, mais à sa manière, qu’il avait aussi choisi, lui qui ne voulait pas s’afficher à gauche, de se laver des rancœurs de la guerre… On le prétendait de droite mais je le situais plutôt dans un parti humaniste, sorte de centre politique intelligent qui se méfiait cependant, l’expérience paternelle lui servant de boussole, de tout engagement politique braqué qui se voudrait d’éternité... En bref, Eugène Ionesco justifiait ses options de théâtre, ses préférences de goûts et ses choix, que les pièces des trois grands étaient dogmatiques, sclérosées et sclérosantes, représentatives d’une gauche qui se voulait libérale mais qui, pour être entendue, par compromission avec le public et pour l’inséminer – il disait contaminer –, tombait sans s’en apercevoir dans le piège d’un conformisme de structure et de forme, déjà périmé et pour lui hors d’usage.
Pour le lecteur je rappelle que Sartre, Beauvoir et Camus avaient investis l’arène et qu’ils avaient été les principaux initiateurs du théâtre contemporain de cette époque. Une forme de théâtre certes d’un genre nouveau, avant tout humaniste et politique, en corrélation presque parfaite avec les contextes historico-sociaux de l’Après-Guerre, et tellement adaptée et en conformité avec ces contextes, qu’on aurait pu jurer qu’elle serait désormais, pour toujours, considérée comme historiquement incontestable…
« ...Au point d’avoir “inondé le marché” me dira Eugène Ionesco, et fait le vide de tout ce qui ne lui ressemblait pas… Alors qu’à bien y regarder, ajoutait-il en haussant les sourcils, ce genre de théâtre relevait d’une historicité transitoire, ponctuelle et provisoire, qui ne passerait pas, sur le plan des pratiques, à l’histoire avec un grand H !... »
Et puis, se rattrapant, en riant, il finissait par dire : « Comme le mien d’ailleurs !... Ainsi en vont les choses !... Même les empereurs finissent par mourir et être remplacés !... Je suis, pour un instant d’éternité dans le courant de l’actualité mais pour un instant seulement !... »
Pour un rappel et que le lecteur puisse en juger, ce théâtre-là, celui de Sartre, ou de Sartre particulièrement critiqué et influencé par Beauvoir, et celui de Camus, s’est illustré par de nombreuses pièces dont je peux encore citer les noms comme ils me viennent à l’esprit, sans pour autant les attribuer à l’un, l’une ou l’autre d’entre eux-trois : Caligula, Huis Clos, Les bouches inutiles, l’État de siège, Le diable et le Bon Dieu, Les mouches, La putain respectueuse, Les Justes, Kean, Les séquestrés d’Altona, le Malentendu, les Possédés…
Ionesco me disait en somme que, comme Lope de Vega l’avait instauré en 1540, en décidant qu’il officierait pour un “theatro nuevo” (théâtre nouveau) fait de “comedias de capa y d’espada” (comédies de cape et d’épée), ou “d’auto sacramental” (Miracles, légendes et mystères) empreint de métaphysique… il avait voulu proposer, sans savoir si cela plairait au public, probablement à partir des théories brechtiennes de distanciation – Celles qui incitaient le public à ne plus se laisser soumettre et séduire, par identification aux personnages de cet environnement circonstanciel, jusqu’à en perdre son libre arbitre –, une autre forme de théâtre, selon un processus de déstabilisation verbale dont le but apparent semblait être de destruction du langage alors qu’il visait en fait, de manière plutôt volontairement constructiviste, à une reconsidération des réalités et à une reconstruction de l’idée qu’on s’en faisait.
Le théâtre à Paris était, disait-il : « Plombé... Trop à la mode... Trop plébiscité comme un amusement d’après-diner... Trop bien convenu pour l’agrément d’un public de classe !... »
Des critères de fabrication qu’il refusait tout net puisque, pour rien au monde, il entendait se voir ranger dans cette catégorie-là …
Emphatiquement, comme s’il sonnait un glas, Eugène Ionesco résuma sa diatribe : « Il fallait faire autre chose pour ne pas copier Sartre et Camus !... Car c’est un théâtre qui vieillira et qui finira mal !...»
J’avais l’impression d’entendre un jeune homme parler de ses ancêtres alors que né en 1909, il avait 55ans et était de la même génération et promotion que Sartre né en 1905, âgé de 59 ans, de Christiane Faure née en 1908 (54 ans) et de Camus le plus jeune des quatre, né en 1913 qui aurait donc eu, s’il avait vécu 51 ans à cette époque-là, en 1964…
Curieusement, lorsque je résumais toutes ces influences que j’avais subies, je m’aperçus qu’elles allaient dans le sens, en les devançant même, de cette pédagogie de conscientisation dont m’avait instruit Réné Zazzo l’auteur du Paradoxe des jumeaux – l’incitateur pour Michel Tournier de son livre Les météores –, dont le dilemme était toujours de pouvoir dégager du couple gémellaire monozygote, “utérinement” constitué, l’émancipation d’un moi individualisé et autonome…
**************************************************
Et, de fil en aiguille la question que je me posai en cet été 1960 était : Christiane Faure avait-elle réellement et précisément choisi, elle-même, cette pièce d’Eugène Ionesco pour figurer dans cette inauguration de son Petit Théâtre d’été ?...
Il y avait un tel décalage entre les pièces que Georges Robert-Deshougues avait montées depuis qu’il était aux manœuvres dans ces Mouvements de Jeunesse, et cette pièce d’Eugène Ionesco, que j’en vins à déduire que c’était peut-être seulement Georges Robert-Deshougues, de sa propre initiative, sans le chaperonnage de Christiane Faure pour l’induire dans ce sillage de Camus, qui avait toujours choisi de s'y maintenir, par goût et par conviction politique, en ne choisissant que des pièces, de type méditerranéen, dont il était prévisible qu’elles auraient l’agrément du plus grand nombre et qu’elles plairaient plus précisément à son public oranais…
Mais je n’étais pas sûr et certain de ce que j’avançais !
Il me semblait plus sage de penser que Christiane Faure et Georges Robert-Deshougues, réagissaient plutôt et avant tout, en bons agents disciplinés de l’Éducation Nationale française, en ne prenant à leur compte que les pièces qui correspondaient à son traditionalisme conformiste institutionnel, celui qu’avaient instauré les générations nées avec le siècle. Celles qui avaient l’âge de mes parents nés en 1900 et 1903 et qui avaient été approuvées par Camus… celles qui fondaient en somme ce fameux sillage de Camus dans lequel je me trouvais engagé.
***********************************************
Pièce drôle et surprenante à plus d’un titre, que cette Cantatrice chauve dont le suspense se crée autour d'une attente, celle d'une arrivée qu'on espère, qu'on envie même, que veuille bien apparaitre enfin cette inexistante et pourtant omniprésente "Cantatrice chauve” alors qu'elle se contentera de se faire désirée et n'apparaîtra jamais en laissant finalement le spectateur sur sa faim...
C’est au cours d’une des répétitions de cette Cantatrice chauve, pièce dans laquelle je n’étais pas distribué, que je serai, pour ma part, moi qui estimais ne pas mériter le coup de fouet que je souhaitais aux autres spectateurs de ce Petit Théâtre d’été, marqué de manière profonde et grave, fouetté réellement et avec vigueur, mais pour être revigoré, sainement et culturellement, alors que je n’étais qu’un simple spectateur-stagiaire attentif et curieux de ce que mes amis de l’AEAJ, Georges et Janine Lorenzo, Yvette-Julie Saget, et Claude Chebel, celui qui m’avait invité, allaient bien pouvoir donner de bon, dans cette pièce d’un auteur inconnu…
Rétrospectivement, l’enchantement que j’éprouvai ce jour-là me paraît relever d’une magie car rien n’était prévu pour que j’assiste à cette répétition, sinon que Claude Chebel, avec qui j’avais diné la veille, qui tenait un rôle dans cette Cantatrice Chauve et qui était en charge, en l’absence du metteur en scène Abderrahmane Kaki, de mener les répétitions, m’avait aimablement invité à le retrouver pour que je lui donne mon avis.
Car Eugène Ionesco, de son esprit ironique surprenant et par son invention créatrice, maniait un fouet qui me rappelait, celui que j’avais pu trouver dans l’univers de la Comtesse de Ségur. Dans un bon petit diable, plus précisément où la menace de punition infligée, devenait, par identification du lecteur avec le petit insolent qui risquait de se voir administrer les coups de martinet, une occasion de s’insurger contre la revêche Mme Mac Miche et d’affirmer, en réaction de défense légitime, sainement, toniquement, non seulement qu’il ne la méritait pas mais que c’était le principe de flagellation et l’autoritarisme de la menaçante qui méritaient d’être sévèrement réprimandés et punis.
Juste retour de bâton qui insufflait au lecteur et au spectateur, qu’il fallait vouloir et savoir être soi-même. Que l’important était d’être déterminé à ne pas se laisser devenir celui qu’on ne voulait pas à être et à se battre, y compris avec soi-même, pour devenir celui qu’on voulait être…
Fouetté et marqué à vie je fus, en cet été 1960, puisque c’est de cette blessure à vif – Oui, l’humour scarifie aussi !... –, et de la belle cicatrice que j’en garderais, que me viendront le courage, moins de quatre ans après, de solliciter Eugène Ionesco pour lui demander de bien vouloir écrire pour les enfants.
Claude Chebel et Yvette-Julie Saget, amoureux, sur la plage de Bouisseville
*******************************************
C’est là, ce jour-là, à Bouisseville, que je devais retrouver aussi, Jean-Pierre Larruy et qu’il fit appel à moi, sur recommandation d’André Ehrman, le directeur du Conservatoire d’Oran, dont il était un ancien élève, pour que j’assume la régie du spectacle L’échange de Paul Claudel qu’il avait monté spécialement pour ce Petit Théâtre d’été avec des élèves de ce conservatoire.
**********************************************
Pour le détail et pour qu’il n’y ait pas de confusion : je n’avais pas eu l’honneur de suivre les cours de ce Conservatoire Municipal d’Oran, dont un de mes amis de l’AEAJ, Camille Covacho, m’avait souvent parlé.
Un peu trop souvent même, en articulant emphatiquement ses paroles comme le lui recommandait Monsieur Héral, l’ancien directeur de ce Conservatoire, tout en se flattant d’être communiste, de parents communistes, et fier de l’être…etc…
En répétant, comme si le fait de faire partie de ce conservatoire était un privilège du ciel : « Monsieur Héral nous disait, toujours… Monsieur Héral nous recommandait de ne jamais… Monsieur Héral par ci, Monsieur Héral par là…etc
Si bien que, à force d’entendre parler de ce Conservatoire, de ce Monsieur Héral, et de cette manière-là… l’idée même que je puisse en faire partie me sortait par les trous de nez…
Alors pourtant que j’avais très envie, et même besoin, d’apprendre à mieux placer ma voix, à mieux articuler... ne serait-ce que pour mieux servir les textes que j’avais à dire et mieux les restituer face au public…
En fait de quoi, d’une manière sottement définitive, j’avais décrété que ce Conservatoire d’Oran n’était qu’une école pour gosses de riches où on ne pouvait apprendre qu’à faire des manières et à devenir des mirlitons et des petits singes savants …
************************************************
Jean-Pierre Laruy, de son vrai nom Jean-Pierre Lévy, oranais de naissance, avait suivi des études brillantes, comme Claude Chebel, dans un des trois lycées parisiens qui avaient la cote. Lui, au Lycée Henri IV, alors que Claude Chebel sortait du Lycée Louis Legrand.
Des établissements institutionnels dont il était de bon ton de se recommander puisqu’ils donnaient droit ensuite, à titre de reconnaissance d’esprits supérieurs, à des postes administratifs éminents dans les institutions de culture, d’éducation, où même dans des cadres des pouvoirs politiques. Constat que je pus aisément faire au cours de mon cheminement en édition, en côtoyant des carriéristes hommes et femmes, haut placés dans la hiérarchie administrative et sociale, en poste dans des services institutionnels, s’occupant d’éducation ou de culture pour l’enfance et la jeunesse et qui me toiseront du haut de cette appartenance comme si je n’étais pas fondé pour m’occuper d’édition : l’exemple type étant pour moi le père Antoine Maurice Cocagnac, directeur du département jeunesse aux Éditions du Cerf qui avaient suivi ses études au Lycée Charlemagne puis sa formation artistique à l’École des Beaux-Arts de Paris.
Passionné de théâtre, Jean-Pierre Laruy fera carrière, en suivant, après le Lycée Henri IV, les cours de théâtre à l’École d’art dramatique de la rue Blanche et, peu de temps après, en prenant la responsabilité et la direction du Centre dramatique National du Limousin à Limoges, où j’assisterai à quelques spectacles sur invitation de Lucette Filiu qui faisait partie de la troupe de Jean-Pierre Laruy avec un de mes jeunes camarades du Cours Dullin, Rodolphe Bérac.
Jean-Pierre Laruy et moi nous étions connus l’année d’avant, puisqu’il avait été distribué comme moi dans l’Espagnol courageux et avait fait partie ensuite – comme moi aussi, au titre de figurant seulement –, des comédiens de l’AEAJ qui apportaient ainsi leur concours, bénévolement, à Jean Davy, directeur des Tréteaux de France, et aux interprètes : les sœurs Mallet, Odile et Geneviève, Georges Descrières et Catherine de Seynes… pour des représentations de la pièce de William Shakespeare, Othello, dans le Fort de Mers-el-Kébir et dans le cadre précis du 2ème Festival de théâtre de Mers-el Kébir.
Catherine de Seynes (Desdémone), Jean Davy, directeur des Tréteaux de France, Paul Gardissat et moi au cours d’une répétition de Othello de William Shakespeare
**********************************************
Pour le Petit Théâtre d’été, dans cette version de L’échange, montée par Jean-Pierre Laruy, l’interprète féminine principale était aussi une élève du Conservatoire d’Oran. C’était une jeune apprentie comédienne, issue de la bourgeoisie riche, juive, oranaise, Nelly Benhamou. Une jeune fille sage, charmante, attentive, discrète, bien sous tous rapports, que je retrouverai à Paris, en 1963, au Cours Dullin.
A qui, je demanderai donc, de bien vouloir me donner la réplique et d’être “ma” Dona Sol dans la pièce de Victor Hugo Hernani…
Puis que je retrouverais plus tard – elle et moi ayant renoncé au théâtre –, alors qu’elle était devenue bibliothécaire, au Centre Pompidou, sous l’égide de Jean-Pierre Seguin, dans cette bibliothèque pour la jeunesse, qui avait été implantée, en ajout, sur le terreplein, à l’extérieur du Centre, la raffinerie comme nous l’appelions, sur le parvis proprement dit du “Musée Pompidou”.
Bibliothèque qui ne durera malheureusement que quelques années, mais dont la conservatrice, intelligente, courageuse et efficace, Christiane Abbadie-Clerc, réussira néanmoins l’exploit d’organiser deux des plus belles des expositions de livres pour la jeunesse que j’ai connues : Images à la page et Les visages d’Alice…
***********************************************
De cette participation au montage de L’Échange, pièce qui comptait beaucoup pour moi puisque j’étais et suis resté un fervent admirateur de Paul Claudel, de son imagination, du rythme de ses phrases et, probablement aussi, parce que j’avais en tête, le talent et la tragédie qu’avait vécu, dans l’ombre de Rodin, sa sœur Camille… je retins une phrase, prononcée par son personnage principal, Louis Laine, dont je m’appropriai aussitôt le sens pour m’en faire une devise et une règle de vie « Il faut goûter chaque herbe pour connaître le goût qu’elle a »…
Une phrase qui, à partir de ce jour d’été-là, me donna des ailes !
Des ailes qui, bien entendu, je dois le reconnaître, même si je ne m’en excuse pas pour autant, ne furent pas toujours d’ange… puisqu’il fallait ajouter au goût des herbes diverses auxquelles je fus confronté, le goût des risques qu'il me fallut encourir ! … Des ailes qui me donnèrent le sentiment de conforter et d’authentifier mes aspirations naturelles et surtout cette curiosité et ce désir de savoir qui m’avaient toujours poussé à vouloir toucher du bout des doigts, comme Saint Thomas, ce qu’était la vie, ce qu’elle nous offrait implicitement dans son endroit et son envers…Et quelles étaient et seraient, pour chacun de nous, différemment et diversement, les opportunités de destins qu’elle nous réservait…
Entendons-nous bien toutefois : dans la perspective d’explorations, car il s’agissait pour moi simplement de goûter !... de goûter seulement !... D’apprendre à connaître, en gourmet, les bonnes et les mauvaises herbes et, parmi elles, les vénéneuses !... Ne déguster que les bonnes !... Apprécier néanmoins les amères et les âpres !... Mais sans jamais se goinfrer, ni devenir addict !...
Pour un bref rappel historique, je dirais que la première version de L’échange fut présentée, la première fois, au Théâtre du vieux Colombier, à l’initiative de Jacques Copeau, en 1914, et que c’est Charles Dullin qui interprétait alors ce Louis Laine, jeune homme aventureux, qui rêvait d’apprécier chaque herbe de l’univers…Jacques Copeau instaurant de la sorte, L’Échange, comme une pièce phare du patrimoine, que reprendraient à sa suite Georges Pitoëff en 1917, puis Ludmilla Pitoëff en 1940 et en 1946... Avant qu’Hubert Gignoux, en 1950, ne l’adopte pour la transporter hors de Paris dans le Centre dramatique de l’Ouest… Puis L’Échange fut repris en 1951 par la compagnie Renault-Barrault et en 1986 par Antoine Vitez…
Au risque d’insister, je répète que je fus transporté, au cours de cet après-midi de l’été 1960, invité, par Claude Chebel, que je ne remercierai jamais assez, à entrer dans cet autre monde, absurde et typiquement Ionesquien, de la cantatrice chauve, d’autant plus que la pièce était interprétée par quatre de mes amis : Georges et Janine Lorenzo, Claude Chebel et Yvette-Julie Saget.
Janine Palma-Lorenzo en Mme Smith avec Jean-Pierre Tailhade ( le pompier)
La répétition était tellement désopilante, riche de suggestions et d’inspirations que, n’en revenant pas, je restais “tout-yeux, toute-oreille” figé sur mon siège et d’autant plus séduit et ravi que mon fils, qui avait sept ans alors, était avec moi, partageant aussi, les yeux grands ouverts, l’insolite des situations ubuesques que les comédiens déroulaient devant nous en s’efforçant de garder leur sérieux…
Figuraient aussi, dans cette distribution, une jeune fille, interprète de Mme Martin qui venait comme Claude Chebel du Groupe de Théâtre Antique de la Sorbonne… et Yvette-Julie Saget, (Mary la bonne) qui deviendra par la suite l’épouse de Claude Chebel… ainsi que Jean-Pierre Tailhade, qui interprétait le capitaine des pompiers, issu du Lycée Henri IV et du Groupe de Théâtre Antique de la Sorbonne, acteur et metteur en scène, qui fondera peu de temps après avec Ariane Mnouchkine Le Théâtre du soleil…
Quoi qu’il en soit, cet après-midi-là, de cet été 1960, passée avec mon fils à Bouisseville, tout proche de la maison que nous avions loué avec mon épouse et mes beaux-parents dans la station voisine d’Ain-el-Turck, reste dans mon souvenir, pour toutes sortes de raisons qui deviendront par la suite exceptionnelles en fonction de l’aggravement des événements en Algérie, comme un moment de vie exceptionnel et inoubliable.
Et puis c’est au cours de cette répétition que, pour la première fois, surprenant mon fils, sept ans alors, qui, comme un grand, riait aux éclats, je pus prendre conscience, en même temps, mêlés inextricablement, le fait qu’il n’était plus ce petit enfant que j’aurais souhaité qu’il reste et, à la fois, qu’il était normal qu’il soit sensible à la force dynamique et stimulatrice de cette qualité percutante d’humour d’Eugène Ionesco.
Je pense sincèrement, ne me référant qu’à moi-même et à ma culture théâtrale, que je n’aurais jamais pu imaginer, si mon fils ne m’en avait pas donné aussi concrètement l’occasion, l’ampleur et la portée qu’avait cette qualité d’humour absurde, puisque... Je crois même que j’aurais plutôt eu tendance, toujours par référence au théâtre que j’avais lu et que j’aimais, à penser qu’il s’agissait-là d’un parti-pris intellectuel de pur divertissement... Une sorte de galéjade en forme de bonne blague, bouffonne et corrosive parfois, mais gratuite et réservée aux adultes raffinés et blasés des classes sociales privilégiées.
En bref, Il ne me serait pas venu spontanément à l’idée, que les astuces et les subtilités du style d’Eugène Ionesco puissent être à ce point perceptibles par de jeunes enfants.
Réflexion d’étonnement qui, cheminant dans mon esprit, me permettra de déduire, par la suite, en recadrant cette qualité de théâtre dans le formalisme que je rencontrais habituellement auprès de mes collègues enseignants, que l’humour était une vertu de l’intelligence et que nous ferions mieux, au lieu de le réprimer comme nous le faisions en classe pour obliger nos élèves à rester dans leurs coquilles, de l’inclure dans la relation pédagogique et de l’encourager et de l’entretenir comme un élément de partage convivial, afin qu’il devienne un stimulant d’esprit et de réflexion critique.
Ma réflexion était carrément anticonformiste. On me taxa, lorsque j’en parlais avec quelques-uns de mes confrères, de démagogue et d’incitateur d’insolence… en me prédisant que s'il pouvait bien m'arriver de recueillir, peut-être, éventuellement, quelques perles intéressantes, trois ou quatre tout au plus par année, d’un ou de deux élèves ayant des dispositions, je serais assuré par contre, à les encourager dans ce sens, d'engendrer à coup sûr des interventions désordonnées, des chahuts et des perturbations monstres au cours desquelles, à n’importe quel moment, n’importe qui dans la classe s’autoriserait à dire n’importe quoi…
« Moi, me dira le plus ancien d’entre nous, en classe, je ne crois qu’au respect et à la discipline. Autrefois on nous permettait les coups de règles sur les doigts !... La peur fait taire à coup sûr l’insolence en germe !... Dans ma classe en tout cas, l’humour et la plaisanterie n’auront jamais leur place !»
Je n’en démordais pas moins. Si la relation pédagogique était forte et bien établi, ces excès qu’on me citait n’avaient aucune raison d’être. Je ne voyais plus dans ce dogme du respect et de la discipline avant tout qu’une logique conventionnelle de rond de cuir ou de petit fonctionnaire méticuleux mais déjà installé dans un train-train de préretraité...
Battant ma coulpe, j’en arrivais à penser, en regardant autour de moi, que sans interdire formellement l’humour dans nos écoles, nous nous comportions tout de même, nous, enseignants, comme s’il n’avait pas droit de cité.
Ce constat s’appliquait aussi bien à tous mes camarades de promotion et, par-delà eux, à tous nos confrères qui, comme moi, n’avaient pourtant pas inventé la poudre en matière de pédagogies innovantes…
Ce qui me porta à déduire que cette évacuation s’était faite implicitement dans le temps et que nous en avions hérité, de génération en génération, sans éprouver le besoin, probablement parce que l’humour n’était pas une caractéristique majeure de l’esprit français, de la reconsidérer et de la remettre en cause. Un fait certain s'imposait : notre bible consignée dans nos Instructions Officielles s'abstenait de le nommer et, que ce soit pour l’accréditer comme une vertu de l'intelligence et de la sagacité en nous permettant d'y avoir recours ou que ce soit pour le discréditer par omission en nous incitant à l’ignorer, elle évitait radicalement d'en mentionner l'existence.
Cela étant dit, notre période d’après-guerre était une période charnière. Ni les pédagogies actives ni celles de conscientisation n’étaient survenues fortuitement. Ce qui nous était arrivé ne pouvait pas ne pas avoir eu de conséquences sur nos façons de penser et sur nos manières de nous comporter. Sartre et Camus, Brecht et Ionesco n’étaient pas nés de la pluie !...
Dans l’Éducation Nationale, ces conséquences d’après-guerre nous incitaient alors à reconsidérer notre position d’enseignant et celle, en confrontation avec la nôtre, de nos enseignés. La reconsidération de ces deux statuts nous commandant désormais, à nous enseignants, de restreindre, au nom d’une convivialité de partage, notre traditionnelle supériorité faite d’autorité et d’exigence de respect inconditionnel, pour mieux accorder aux enseignés de véritables droits, ceux de personnes à part entière… Ces conséquences n’étaient pas non plus fortuites. Elles ne pouvaient que se consolider dans le temps et prendraient même un jour force de lois en se concluant finalement, en 1989, par la Convention Internationale des Droits de l’Enfant (CIDE)
Il me sembla en tout cas, dès cet été 1960, sous l’effet de l’humour d’Eugène Ionesco, que nous nous privions à tort, nous, les enseignants, d’utiliser, dans nos enseignements, certaines formes d’esprit de qualités, et que nous devrions, de manière plus générale, dans l’intérêt de la retransmission de nos savoirs et dans l'intérêt des enfants, instaurer l’humour comme une pratique habituelle et un principe de tous les rapports que nous pouvions avoir, à condition bien entendu qu'il ne nuise pas au respect des uns et des autres, avec tous nos semblables.
Même si humour et discipline paraissaient incompatibles, il me semblait néanmoins qu'il serait bon, sans pour autant avoir le sentiment de donner un coup de pied dans la fourmilière, que je remette en question, dans ma classe, avec mes élèves, ce comportement autoritaire d'assujettissement que j’avais adopté, comme une armure, pour leur imposer le respect inconditionnel qu’il me devait et qu'il était temps que je les encourage à me faire davantage part des idées qui leur passaient par l’esprit... Même si elles tombaient à plat, comme un cheveu sur la soupe…
A vrai dire, sans m’en rendre compte, je préparais là tous les arguments qui me serviraient, en 1968, lorsque je publierai les Quatre contes pour enfants de moins de trois ans d’Eugène Ionesco à me défendre contre tous les enseignants et les analystes critiques de la Presse “enfantine”. Mais il m'en couta puisque la célèbre psychanalyste Françoise Dolto en tête, tomba dans le panneau en m’accusant de publier des inepties – Dolto disant franchement et sans restriction : « Ionesco c’est idiot ! » tandis que les dames du Groupe d'édition Bayard Presse, dont Mi-jo Béccaria était la directrice, me reprochèrent de donner aux enfants « des livres qui, en aggravant les difficultés qu’ils avaient à acquérir les mots qui désignaient et identifiaient les objets, ne pouvaient que perturber les enfants et les détourner de la lecture. »
En somme, je pris conscience là, au cours de cet après-midi d'août 1960, dans le cadre de ce Petit Théâtre d'été et d'une des répétitions de La Cantatrice Chauve, d'Eugène Ionesco, mieux que jamais auparavant, que tout le corps enseignant dont je faisais partie et partageais les fondements, les rites, les critères et les codes traditionnels, marchait au pas, comme un seul homme, dans le respect de principes édictés impérativement en loi du genre par tous les Ministère de l’Éducation Nationale qui s'étaient succédés, au nom d’une culture traditionnellement et nationalement française et que ces principes étaient périmés et qu'ils devenaient même aussi nuisibles que des lunette noires que l'on posait en bandeau sur les yeux des enfants pour restreindre leur acuité d'esprit et leur imagination.
Comme il m'était apparu qu’en secouant ainsi le cocotier de mes habitudes, Eugène Ionesco m'avait survolté et dynamisé, je me mis à considérer que je devais le solliciter et m’associer à lui afin que nous puissions espérer, par un répertoire élargi à destination du Jeune Public, contribuer à changer la perspicacité du regard que les enfants porteraient pour envisager leurs vies…
Il me semblait injuste et bête que nous nous les privions de cet outil magique qu’était l’humour et de ses stimulus transgressifs dynamiques… et qu’il fallait que nous admettions, nous, Français, comme les Anglais et comme d’autres nations l’avaient fait avant nous, que l’humour était surtout, même s’il pouvait prendre aussi, parfois, le caractère déviationniste de l’insolence, le signe indéfectible spontané de la perspicacité et de l’intelligence humaine.
La prise de conscience ne s’arrêtait pas là car, souterrainement, elle me permettait de déduire que l’interdiction non-formulée mais soigneusement entretenue, de manière occulte, par omission et par endoctrinement tutélaire en matière d’enseignement, n’avait d’autre but que d’aller dans le sens d’une injonction inconditionnelle à l’obéissance et à l’assujettissement.
C’est-à-dire, pour être plus précis et pour me référer à mon enfance sans livres et à la classe défavorisée d'où j'étais issu, il m'apparaissait pour la première fois aussi précisément et clairement qu'au nom de la logique, de la raison et de la discipline, les ordres venus d'en haut étaient établis à des fins d'assujettissement et de domestication, pour obliger, tous ceux qui ne faisaient pas partie des classes dominantes, à ravaler leurs aspirations d’émancipation, même lorsqu'elles n'étaient que spirituelles et à se conformer au strict respect de l’ordre établi. Avec, pour résultat de conséquence, celui d'importance et des plus négatifs qui engendrait et imposait subrepticement par des voies insondables, aux plus nombreux d'entre nous qui constituons cette grande majorité silencieuse qu'est l’opinion publique, de nous en tenir strictement à la pensée commune, nourrie de qu’en-dira-t-on, de préjugés et d’idées reçues... en adoptant le profil bas et l'uniforme du petit soldat.
Comme mon fils, je suis persuadé que Catherine et Jean, les jumeaux d’Albert Camus et de Francine Faure (sœur de Christiane), qui étaient âgés de 13 ans, ont assisté, puisqu’ils étaient alors en vacances, dans la résidence d’été familiale, construite par l'architecte qu'était leur grand-père, tout près de ce Petit Théâtre d’été, à ces répétitions qui se passaient en plein air et qui étaient ouvertes à tous ceux qui passaient dans le coin …
Sans nul doute ils pourraient confirmer et corroborer ce que j’avance…
D’autant plus que, cet été-là, ce bel été, celui de 1960, fut pour la plupart d’entre nous, en ne parlant que de ceux qui, comme moi, avions fait partie de la troupe de l’AEAJ, le dernier bel été de notre existence en Algérie.
La vie, la belle vie, est brève dit-on habituellement !... Il faut la vivre au bon moment, quand le bonheur est à portée !... Cours-y-vite dit le poème, il va filer…Pour moi, le bonheur que j’éprouvais en Algérie et que je ne retrouverais jamais ailleurs, fila cet été-là !
Avec mon épouse et mon fils sur la plage d’Aïn-el-Turk en juillet-août 1960 : la belle vie !
J’ai encore en mémoire la maison que j’avais louée, pour un mois, à un des chauffeurs de Christiane Faure, employé des services des Mouvements de Jeunesse de la Place Karguentah : une petite villa donnant sur la plage d’Aïn-el-Turck, mitoyenne de celle de Bouisseville...
Dans le terrain, devant la maison, encadré par une palissade, poussait un figuier dont j’aurais bien voulu goûter les figues et désespérais qu’elles murissent... Jusqu’au jour où mon beau-père, ancien enfant adoptif des célèbres Frères Clément, ceux qui avaient inventé la clémentine, dans leur abbaye pépinière de Misserghin – village situé à une cinquantaine de kilomètre d’Oran, où Pierre Loti avait séjourné et où mon épouse était née –, me révéla une de leurs astuces : mettre une goutte d’huile à la base de chaque figue pour pouvoir accélérer leur maturité… et programmer ainsi, en quelque sorte, la veille, selon ses appétits ou le nombre de bouches qu'il aurait à nourrir ou de convives qu'il aurait à sa table, le lendemain, la quantité de fruits à savourer.
********************************************
Ce texte relu plus de dix fois depuis la première écriture a été relu et reprécisé pour être placé dur ce blog ce jour 3 mars 2022
François Ruy-Vidal