1965. MON PREMIER LIVRE : LE VOYAGE EXTRAVAGANT
1965. MON PREMIER LIVRE

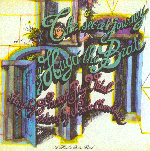

Ce premier livre me fut inspiré lors d'un séjour à New York, alors que j'étais complètement immergé sous un flot de paroles que j'avais du mal à assimiler et que, par la force des choses, je me trouvais, en quelque sorte, réduit à n'être qu'une grande oreille.
Voir et entendre étaient les seules capacités qui m'étaient accordées mais au détriment de toutes les autres facultés : celles de m'exprimer et de donner mes opinions entre autres. En somme, j'en étais presque réduit, par suite de mes faiblesses en anglais et par la réserve que cette ignorance m'imposait, au mutisme et à la rancune.
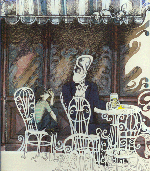
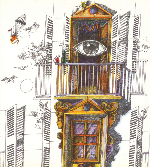
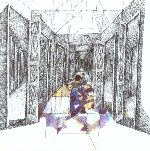
Projection de moi-même, mon double en quelque sorte, le protagoniste de ce "Voyage extravagant" qui comme son nom l'indique, avec un caractère bien trempé, le petit Hugo Brise-Fer, était donc taillé au reflet de ce désir et cette hargne qu'il avait de partager et de participer avec ses semblables puisque sous divers prétextes, dont celui de la barrière de la langue et du dépaysement, il était empêché de contribuer à ce dont il était témoin, à ce qui se décidait sans lui et même à ne pouvoir contester ce qu'on réalisait, sous ses yeux, à partir de l'interprétation de ses idées.
C'est pourquoi, au cours d'un voyage surréaliste et d'une quête initiatrice, Hugo Brise-Fer rencontrera donc une grande oreille... puis un bel œil perdu dans l'extase de ses contemplations ... puis une bouche tonitruante et intarissble... puis un labyrinthe dans lequel il se perdra... avant d'arriver devant le miroir des confrontations qui ne lui renverra pour conforter son identification, qu'une image de sa petite personne en mal d'elle-même.
Le titre original :
"Le voyage extravagant d'Hugo Brise-fer" avait été primitivement traduit pour le marché des États-Unis par :
"The secret Journey of Hugo the brat".
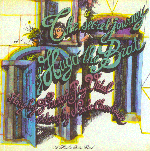
Mais, le terme "the brat" étant jugé plutôt vulgaire et péjoratif en United Kingdom of England, le distributeur anglais de nos livres, W.H. Allen, nous ayant déconseillé d'utiliser ce même titre pour la version anglaise, le titre évolua pour devenir :
"The secret journey of rambunctious Hugo"

Nicole Claveloux l'illustratrice à qui j'avais confié le soin de concevoir les couvertures fut donc contrainte de réaliser trois couvertures différentes puisqu'elle avait pris le parti d'inclure, graphiquement, calligraphiquement, les mots écrits de sa main du titre dans son illustration.
POUR LA PETITE HISTOIRE :
C'est à New York que l'idée de ce livre germa dans mon esprit en juillet-août 1965, quand je pris conscience sur le tas, en voyant Harlin Quist agir et se comporter dans son milieu, avec ses collaborateurs d'édition, de ce que j'avais pressenti en octobre 1964, lorsqu'il m'avait été présenté par son confrère, mon ami, le poète américain John Ashbery.
A ce moment-là, débarqué à Paris en envoyé du plan Marshall et conquistador de Paris, Harlin Quist m'avait asséné, du haut de son expérience en édition, alors qu'elle venait à peine de commencer, pour me gagner à sa cause et me convaincre de lui servir d'introducteur, des jugements définitifs sur la médiocrité de nos auteurs et illustrateurs de jeunesse... Nous ne savions pas en France écrire, illustrer et produire des livres pour les enfants.
Il était notre hôte et je mis des formes pour riposter en lui faisant une critique plutôt négative mais sincère et fondée des dix petits livres en format de poche, vendus à moins d'un dollar, qu'il avait édités et qu'il voulait que j'en sois le représentant. Ses auteurs étaient certes des classiques mais d'une autre époque et sans nouveauté. En conséquence de quoi, aussi bien en matière de texte que d'illustrations, sa collection manquait de contemporanéité. De plus, en raison de leurs formats étroits, j'estimais que les illustrations n'étaient pas valorisées.
Harlin Quist encaissa et mes remarques portèrent. Alors, persuadé que je pouvais l'aider puisqu'il avait apprécié mes connaissances en littérature américaine et mes goûts pour les illustrations, il m'invita à New York, à l'occasion de la mise en chantier de sa nouvelle collection, pour que, travaillant avec son directeur artistique John Bradford, je lui fasse part de mes idées.
Une fois chez lui, à sa disposition, immergé dans sa langue et dans ses activités, le spectacle qu'il me donnait de lui-même, de ses habitudes et de ses pouvoirs, ne pouvait, pensait-il, que m'ébahir et me séduire... Alors qu'en fait, plus discret et plus circonspect, en fonction de ce que j'étais et de ce que j'avais vécu, son comportement m'atterrait et me donnait envie de fuir. De fuir aussi New York où tout était plus haut, plus large, plus grand... mais aussi, souvent, plus factice, plus frelaté et plus superficiel !...
Rien ne semblait m'aller et, comme j'avais déjà refusé à ma soeur, devenue américaine, de partager son rêve, je restai sur la défensive, bien déterminé à faire ce pourquoi on m'avait invité mais sans plus. D'autres pouvaient être subjugués par cet univers foisonnant, bruyant, ultra-rapide, dynamisant mais pas moi. J'étais du type secondaire plutôt timide qu'expansif et je tenais à mon rythme plutôt lent et réfléchi. La confrontation avec Harlin Quist qui, lui, à l'opposé, était plutôt fougueux et toujours pressé, n'était pas pour arranger les choses. C'était la première fois que je le voyais vivre d'aussi près et que j'étais ainsi convié à assister à un tel étalement déploiement de forces démonstratives. Parmi lesquelles surtout, mises en avant pour me séduire et me circonvenir, celles égocentriques et suprématistes... Déterminisme et démonstrations de supériorité qui voulaient parfois m'encourager à sortir de ma défiance pour lui ressembler mais qui se manifestaient toujours plutôt sans ménagement et de manière maladroite. J'en compris la raison lorsqu'Harlin Quist me dira qu'il prenait des cours de chant et qu'il travaillait quotidiennement ses vocalises. Tout était donc prétexte pour lui de parler clair et fort, d'articuler et, souvent, sans raisons valables, de se laisser aller à des éclats de voix tonitruants...
En somme, je prenais conscience que celui qui deviendrait mon associé deux ans plus tard, se démenait et agissait, en show-off et superman sans complexes, comme un manager incontestable, presque un démiurge, prétendant pour justifier ses accès de colère du matin, qu'il n'était entouré – « God Damn ! » –, que d'ignorants incompétents et, bien entendu, qu'il était seul, sur tous les sujets et en toutes occasions, à détenir la perspicacité, la lucidité et le jugement objectif sur la vérité de toutes choses.
Une fois ses accès calmés, chaque jour vers midi, Harlin Quist qui avait une belle voix, se mettait à chanter comme Sinatra “Fly me in the moon ” et “Strangers in the night”. Ses aspirations étant de passer en vedette à l'Olympia et de concurrencer Sacha Distel, Harlin Quist, ne se refusant rien, avait mis la barre très haute en choisissant comme professeur de chant, pour arriver à ses fins, la célèbre Galli, une petite personne par la taille, italienne, qui avait fondé avec la femme de Kurt Weil, la chanteuse Lotte Lenya, un studio d'apprentissage et de maîtrise de la voix très bien fréquenté à New York mais où il était difficile d'avoir une place quand on était postulant et qu'on n'avait pas une voix extraordinaire. Ne présumant de rien, Harlin Quist intrigua en se servant de ses études à Carnegie tech et de son passé théâtral, de la pièce de Tchekhov, Ivanov, qu'il avait montée off Brodway avec Daniel Hyneck, et il fut ainsi engagé pour se retrouver dans le bain et la mouvance des comédies musicales qui se préparaient mais n'aboutiraient que quelques années plus tard. Parmi les élèves du studio de Galli, se trouvaient Lizza Minelli, fille de Judy Garland, et un jeune acteur Joël Grey, tous deux se préparant à la réalisation de deux comédies musicales qui auraient beaucoup de succès par la suite : Cabaret pour Joel Grey, réalisée par Bob Fosse, et New York New York pour Liza Minelli que prendrait en charge Martin Scorsese.
Harlin Quisy vocalisait et roucoulait chaque jour avec application en se félicitant d'avoir, au contraire de Bob Dylan dont il détestait la voix – certainement parce qu'il était comme lui du Minnesota et qu'il en faisait son rival –, une voix qui portait et résonnait bien. En me répétant chaque fois que j'invoquais le mérite et la qualité des textes engagés des chansons de Bob Dylan « But, my god, Franchois, he has no voice ! »
La haine qu'Harlin Quist vouait à Bob Dylan remontait à sa propre enfance, à Virginia, dans le Minnesota et à ce qu'il voulait cacher en ne s'en revendiquant que très rarement : son ascendance suédoise, la pauvreté de sa famille, son père mineur de fond, qui mourra d'une gangrène en suite d'une blessure dans la mine ...
Il avait en lui, pour moi qui voulais le comprendre et l'aider, dans les réseaux et replis intimes et sombres de son caractère, des gouffres insondables qui l'apparentaient aux personnages timorés des films d'Ingmar Bergman. J'en concluais qu'il se torturait l'esprit, serpent qui se mord la queue, la plaie et le couteau, ne sachant pas faire la part des choses pour dissocier en lui, la cause du mal et les horizons que ce mal pouvait lui ouvrir en perspectives s'il choisissait de les distinguer pour les affronter objectivement. Pour ma part, n'ayant pas ces problèmes-là, je ne pouvais accepter d'admettre que ses ambitions et ses désirs de puissance n'aient d'autre but que de camoufler ce passé honteux pour faire de lui, à l'instar du citoyen modèle américain du “strugle for life”, un super héros imbattable et victorieux en tous lieux et toutes occasions.
Harlin Quist, fondant son équilibre à passer d'un pied sur l'autre, n'était à la fois pas fier de son passé d'enfant pauvre mais capable pourtant, en secret, contre son gré, de s'en féliciter. Sachant bien que ce passé était à la fois la cause de ses rancœurs et celle de sa rage de gagner, la raison-source de ses motivations et de sa hargne de triompher. Avec, hélas, ombre au tableau, une autre cause qui semblait être une raison, que je désapprouvais, celle de sa décision de solitude sentimentale, de ne pas fonder une famille, de ne pas vouloir d'enfant... Limites restrictives lui imposant et le condamnant à des aspirations matérialistes et aux petits, vulgaires, mesquins, bonheurs de vivre.
J'ai pensé à lui en ricanant lorsque la Suède, son propre pays, décerna, en 2016, son prix Nobel de littérature à Bob Dylan. Lui, mort depuis 16 ans, qui n'avait eu qu'un malheureux award, dut ressentir un choc terrible. Salutaire peut-être ?... Car je l'entendis me répéter une dernière fois, avant d'avoir un hoquet de dégoût et de se retourner dans sa tombe de désespoir : « But, my God, he has no voice ! »
Pour me convaincre de sa suprématie et m'avoir dans son camp, mais en sous-fifre et à sa dévotion, Harlin Quist croyait que la meilleure manière d'exister et de se battre (struggle for life) était de s'imposer, d'ouvrir sa grande bouche et de gueuler en affirmant ses vérités de manière à les donner comme irréfutables.
C'est avec ces constatations et remarques en tête, en essayant de les occulter, que je vis pour la première fois, cet été-là, sur le petit écran d'une petite télévision, en noir et blanc, dans la salle de séjour de l'appartement d'Harlin Quist du 192 east de la 75 rue, le film de Victor Fleming Le magicien d'OZ (1939) tiré du roman de Lyman Frank Baum. Une histoire en forme de voyage hasardeux qui, d'étapes en étapes, devait mener, en chansons, une jeune protagoniste adolescente, venue du Kansas, à triompher de tous les obstacles qui s'opposaient à elle et de gagner un monde magique idyllique.
Le plaisir que je pris à entendre Judy Garland, interprète de Dorothée, chanter ses espoirs pour vaincre ses déconvenues, fut le facteur déclencheur de mon imagination. Les pièces de mon conte comme les maillons d'une chaine ou comme celles d'un puzzle s'assemblèrent d'elles-mêmes dans le silence de la nuit qui suivit. La première de ces pièces étant la grande bouche d'Harlin Quist, une grande bouche qui souvent parlait pour parler et pour imposer celui qui parlait en faisant taire ceux qui auraient pu avoir envie d'intervenir. Une bouche prétendant toujours énoncer la vérité mais en réfutant souvent, pour ne pas être prise en faute, celles, au pluriel, que je pouvais suggérer pour lui faire simplement remarquer la relativité des points de vue et la pertinence des miens... De la grande bouche je passai à la grande oreille puis à un beau grand oeil qui représentait pour moi, en mémoire de celui que j'avais vu à l'église autrefois, lorsque j'étais enfant, entouré d'un triangle, la conscience.
De ces trois rencontres imaginaires découlèrent un périple surréaliste, initiatique extravagant, que pourrait entreprendre un petit entêté insolent, un brise-fer, qui refuserait d'entrer dans le jeu mais qui s'y verrait contraint et saurait ensuite, alors, découvrir en lui-même, au cours d'une série de rencontres révélatrices, ses facultés intimes et les capacités qu'elles lui octroyaient d'en user.
Il s'agissait pour moi de dire aux enfants que la vie n'est jamais simple, qu'elle est pleine de risques, que nous n'avons aucune garantie de pouvoir et de savoir bien la vivre mais que nous avons en nous, à notre disposition, des organes et des pouvoirs pour nous protéger et nous défendre, qui nous permettent aussi, en les assumant, de réussir à mieux devenir ce que nous pouvons devenir.
Comme Dorothée, partie en téméraire et en oie blanche, à l'aventure, avec son petit chien Toto, sur la route de brique jaune vers un royaume magique qui serait celui des révélations, Hugo Brise-Fer entreprend son voyage extravagant en enregistrant, à partir de chacune de ses rencontres, ce dont elle lui permet de prendre conscience afin qu'il puisse trouver le sens de sa vie.
Dorothée et Hugo étaient de la même famille.
En écrivant, au fur et à mesure que je m'investissais dans ce voyage surréaliste, j'eus l'impression que j'avais mis les pieds dans un domaine tellement gigantesque qu'il était plus imaginaire qu'exactement réel, mais, cependant, que je ne m'étais pas perdu puisque je faisais partie du même clan et que nous partagions les mêmes affinités... etc... Si bien que c'est en suivant Dorothée dans les péripéties de son voyage initiatique en parcours d'obstacles, d'étape en étape, pour atteindre son pays magique, que mon inspiration m'engagea, pris au jeu des découvertes successives, tandis que j'entrais, pas à pas, dans ce domaine intime, secret mais immense, de nos possibilités intérieures.
Comme Dorothée qui rencontrait d'abord un épouvantail sans cerveau, puis un bûcheron de fer blanc sans cœur, et enfin un lion sans courage, mais de manière différente, Hugo Brise-fer va rencontrer une oreille capable de tout entendre, une grande bouche qui prétend être seule à dire la vérité, puis, symbole de notre conscience, un bel oeil qui contemple le monde... Trois organes de chair très précisément concrets de notre corps qui l'inciteront à réfléchir et, par introspection, à retrouver à l'intérieur de lui, dans son esprit, moins palpables et moins facilement décelables parce que spiritualisés, mais aux commandes des trois premiers et de nos perceptions des choses, ces facultés intellectuelles auxquelles il pourra recourir pour entreprendre son voyage.
Entendre, voir, parler, connaître, savoir, réfléchir, apprendre et apprendre à apprendre... puis dire ou se taire, prendre parti ou non, décider d'agir ou pas... constituant les clés, les outils, les moyens dont nous disposons en viatique pour accomplir notre voyage... Il me fallut établir, pour donner de la cohérence au conte, en partant de cette voix tonitruante qui prétendait asséner la vérité, un recensement-bilan de toutes les rencontres déterminantes que chacun de nous pouvions faire au cours de nos chemins de vie. Ces chemins constituant un labyrinthe d'énigmes vers lequel on était forcé d'entrer et dont on ne pouvait sortir qu'en trouvant en nous-mêmes les clés et astuces d'utilisations de nos forces secrètes.
Il me semblait indispensable d'avertir les enfants que ce voyage que chacun de nous doit faire est notre part de destin, qu'il ne dépend pas que de nous-mêmes et de notre volonté consciente ou inconsciente de choisir, mais qu'il dépend un peu tout de même des chemins que nous prenons et de la manière dont nous nous servons de nos moyens organiques personnels et de nos forces intimes.
Ce Voyage extravagant était en somme l'occasion d'un rappel à l'intention des enfants – que certains trouvèrent trop didactique –, des outils organiques, sensoriels, émotionnels, intellectuels et physiques, plus ou moins développés et adaptés, selon chacun de nous, en acuité, sensibilité et capacités, dont nous disposons pour mener à bien, si nous nous efforçons et savons en tenir compte, notre voyage.
Un voyage singulier, caractéristique de notre individu, reflet de nos ambitions, des chances ou des malchances qui nous sont dispensées, des rencontres que nous faisons, des personnes que nous aimons ou qui nous aiment, mais toujours, puisqu'on ne recommence jamais deux fois sa vie, exceptionnellement unique... En sachant aussi, sans que nous n'y puissions rien, qu'il se fera sans aucunes garanties d'accomplissement et de réussite.
Le premier prix accordé au livre pour la qualité des illustrations de Nicole Claveloux, par le jury du New York Times, dont faisait partie Maurice Sendak, était à plusieurs titres un pied de nez à Harlin Quist qui n'avait jamais approuvé et aimé le talent et les divers styles de la jeune illustratrice que je venais de découvrir. Son dédain était presque empreint d'hostilité. Venu en France avec l'idée que nous n'avions jamais eu de bons livres pour enfants, il se cabrait et persistait à tenir son pari stupide. A tel point qu'il nous avait obligé, Nicole Claveloux et moi-même, à devoir nous résigner, pour que le livre paraisse – Mon contrat d'association avec Harlin Quist n'étant pas alors signé et la société d'édition dont je serais l'éditeur n'étant pas créée –, à devoir accepter que le livre ne soit pas réalisé en pleines couleurs – comme l'avaient été Sans fin la Fête et L'arbre, réalisés par Étienne Delessert et son épouse Eleonor Schmid –, mais de manière plus rudimentaire et plus pénible pour l'exécutante Nicole Claveloux, selon le principe de la pré-séparation manuelle des couleurs des traits de contours en noir.
Un procédé plus artisanal qui obligeait l'illustratrice à se plier à exécuter les contours de ses illustrations au trait, en noir sur du kodatrace (feuilles de plastique opalescent ), puis, dans un second temps, après photogravure de ces dessins en noir, à ne disposer ses couleurs que sur des reproductions de ses illustrations imprimées, en bleus inactiniques, sur du carton à dessin...Travail ingrat et pénible qui ne pouvait donner, Nicole Claveloux ayant du mal à percevoir les contours de ses illustrations reproduites dans ce bleu très clair qui serait imperceptible à la caméra, que des résultats approximatifs et décevants... Mais dont elle s'acquitta cependant comme une battante, honnête et vaillante, convaincue de l'authenticité de son inspiration et de la sureté de son tracé.
Elle agissait déjà, là était sa force, en vraie professionnelle, alors que c'était son premier livre. Comme si elle ne s'était pas aperçue des dédains et mépris d'Harlin Quist, alors qu'il insistait à vouloir me convaincre et m'imposer, après m'avoir dit que le style de Nicole Claveloux était trop français et qu'il n'y était pas sensible, que ses illustrations étaient « unprofessional ».
A découvrir aussi
- 1968. IONESCO?... POUR LES ENFANTS?... C'EST PAS SÉR
- 1971. PLUSIEURS GENRES D'IMAGES : COLLECTION 3 POMMES
- 1976. PRENDRE OU NE PAS PRENDRE LES CHOSES AU PIED DE LA LETTRE
